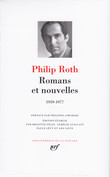La Pléaide
Recherche rapide
Le Cercle de la Pléiade
- La Pléiade /
- La vie de la Pléiade /
- L’actualité de la Pléiade /
- Philippe Jaworski préfacier de de Philip Roth
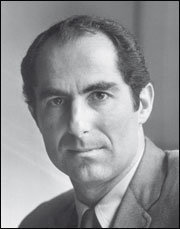

-
Nouveauté
Anonyme
Les Mille et Une Nuits I, II et IIIParution le 21 Mars 2024
En savoir plus
201.00 €
Philippe Jaworski préfacier de de Philip Roth
En octobre paraissent les Romans et nouvelles (1959-1977) de Philip Roth. Ce volume est le premier de l’édition des œuvres de Roth dans la Pléiade. Comment cerner une telle œuvre, qui paraît achevée (c’est du moins ce qu’a annoncé son auteur), mais qui, hier encore, se donnait régulièrement à voir, dans les librairies, sur les tables réservées aux nouveautés ? Philippe Jaworski a bien voulu jouer le jeu et embrasser en une vingtaine de pages, et pour ainsi dire sur le vif, plus d’un demi-siècle d’écriture. On propose ici le début de sa préface.
Enfant de Weequahic, le quartier juif de Newark (New Jersey) où il est né en 1933, petit-fils d’immigrés venus de la Galicie polonaise, Philip Roth a écrit et publié entre 1955 et 2010 trente et un livres, et décidé alors de ne plus écrire de romans. Une biographie de l’auteur est, dit-on, en cours de composition. Elle peindra l’homme, l’écrivain peut-être. Tentera-t-elle — la tâche est redoutable et périlleuse — de mettre au clair le lien complexe par lequel l’homme n’a cessé de se prêter à sa fiction, non pas de se donner à elle, pour lui permettre de vivre sa vie dans la seule compagnie de ses lecteurs ? L’homme s’est beaucoup exposé et expliqué, pour des raisons qui le regardent, dans des articles et des entretiens qui ne concernent ses romans que de manière marginale et accessoire. On le sait, il a dû affronter, depuis la publication de La Plainte de Portnoy (1969), un procès bruyant et confus en égotisme, au motif que certains de ses livres pouvaient passer pour des règlements de comptes personnels mal déguisés. Son génie créateur, pendant trois décennies, s’est chargé de répondre pour lui, prenant pour sujet la puissance du ressort et des ressources biographiques dans la création littéraire, et montrant que la part de la biographie d’un écrivain dans ses écrits de fiction n’est connue et saisissable que par la fiction elle-même. Qu’est-ce d’ailleurs que l’homme, pour qui s’est fait tout entier littérature ? Et qu’est-ce qu’une vie d’écrivain ? Qui dira où elle commence et où elle finit ? Sommé de se défendre, Roth a fait de l’écrivain le personnage central d’un vaste cycle de romans et de «confessions», où il dit tout ce qu’il sait de son métier. L’homme, alors ? Lisant et relisant Philip Roth, si enclin à faire croire qu’il s’exhibe corps et âme pour mieux demeurer à distance de lui-même, on songe irrésistiblement à cet aveu que Joseph Conrad faisait à son ami Edward Garnett le 23 mars 1896, la veille de son mariage : «Une fois que l’on a saisi cette vérité que la personnalité n’est que la mascarade ridicule et vaine de quelque chose de désespérément inconnu, on n’est pas loin d’atteindre à la sérénité.» Mascarade : c’est sous ce signe que se place l’entreprise littéraire de Philip Roth. Romancier de la conscience de soi, il met en scène les aventures cocasses ou pathétiques d’un moi en quête de sa vérité, sur le mode — et selon un scénario — que la littérature d’outre-Atlantique nous a rendu familier, qui donne pour rêve et ambition au héros l’affirmation de sa liberté. Rompre les attaches, s’émanciper, vivre les vies qui s’offrent à soi au gré de ses désirs, sans autre loi ni autorité que celles que l’on se donne… L’histoire a été souvent contée. Quand Roth prend la plume pour en écrire sa version, il y apporte la dimension de la dérision : on ne devient que ce qu’on est, et on ignore ce que l’on est. La vie se joue sans vous.
Philip Roth : écrivain juif américain. Né aux États-Unis, né Juif. Une double appartenance. Est-ce bien le mot ? S’agit-il d’une origine, de deux ? Quels destins promettent-elles l’une et l’autre, l’une sans l’autre, ou encore l’une contre l’autre ? Et que signifie ou représente une appartenance ? La question surgit dès les premières nouvelles de Goodbye, Columbus (1959), âpres chroniques de révoltes et de ruptures. Un adolescent traite son rabbin de salaud; un homme vieillissant cesse de se reconnaître dans la vie qu’il mène ; un avocat chargé de débarrasser son quartier d’un juif orthodoxe revêt l’habit noir de ce dernier et parade en ville comme s’il était devenu l’étranger indésirable ; un sergent harcelé par un soldat juif manipulateur lui accorde quelques exemptions du régime militaire avant de satisfaire son propre désir de vengeance en l’envoyant sur le front du Pacifique. Où sont les loyautés ? À quelle loi obéir ? Le moi se dresse tout à coup contre l’enseignement des pères, un ordre domestique qui lui est devenu haïssable, la tyrannie des préjugés ambiants, la multiplicité des allégeances qui sollicitent l’intelligence et la sensibilité. Quel est le vrai moi ?
«Est-ce moi MOI MOI MOI MOI ! Ça doit être moi… mais est-ce moi ?»
«Je n’ai même plus l’impression d’être Lou Epstein.»
Qui est ce «Je» différent ? Une hypothèse ? Une posture ? Un état passager de l’être ? Ces histoires ne retracent pas la biographie d’un personnage, genre romanesque que Roth pratiquera avec passion par la suite. La nouvelle interdit la chronique, l’exposé des circonstances ; c’est un instantané, et le nouvelliste va droit au moment décisif, celui où le personnage, se regardant dans le miroir, y contemple un visage qu’il ne connaît pas, ou s’y découvre double. Le désaccord affecte simultanément le moi et sa relation au monde. Alexander Portnoy est le premier des personnages qui raconte son histoire de fils juif brouillé avec le judaïsme. Il la parle, plutôt, avec la fureur qui sera plus tard caractéristique des héros de Roth scandalisés par la découverte du non-sens de leur vie, mais c’est une colère où la lamentation se mêle à l’exaspération, la jérémiade au mécontentement de la victime demandant réparation — à quel tribunal ? Il joue et rejoue ses malheurs. Quel est le sens de tout cela ? Qu’ai-je fait pour mériter les épreuves qui s’abattent sur moi ? On reconnaît les questions torturantes de Job. La souffrance d’Alex l’apostat (c’est ainsi qu’il se désigne) est réelle, mais Roth la met en scène et en voix sur le mode de la farce. Sur le divan de son psychanalyste, Alexander est à la fois patient et acteur bouffon : il fait son numéro devant son public — le médecin, c’est-à-dire le lecteur. Le récit de soi tourne au tall tale d’alcôve : avec chaque copulation, l’aventurier part à la conquête de l’Amérique, explique-t-il. Toutes les extravagances verbales sont permises (pas de censure, telle est la règle), comme si, incapable de se libérer des liens qui l’entravent, Portnoy compensait sa condition d’âme en peine éternellement empêtrée dans les chaînes du désir coupable par une liberté de parole sans limites. Certes, il peut afficher avec fierté son rôle de libérateur professionnel (il défend les opprimés, les exploités, les pauvres et les humiliés), et se conformer ainsi publiquement au statut de bon fils défini pour lui depuis toujours ; mais pour ce qui est de sa vie personnelle, sentimentale, sexuelle, la débâcle continue, sans espoir de guérison. D’où celle-ci pourrait-elle venir ? Le psychanalyste ne dit mot (il a déjà étiqueté le cas dans l’exergue du roman). Est-il nécessaire ? Après tout, Portnoy connaît son Freud, mais son vernis de culture analytique ne lui est d’aucune utilité. Il tourne en rond, le fils coupable hurle sa détresse jusqu’à la dernière page. Roth suggère ici pour la première fois l’inefficacité d’une grille explicative maniée par qui cherche à comprendre ce qui lui arrive, ou lui est arrivé. On ne s’explique pas soi-même — et le docteur Spielvogel n’aura été que le témoin muet de l’exposé rageur, jubilant, plaintif, délirant, d’un enfant en exil dans sa souffrance. Par la suite, Roth se tournera vers une autre figure d’autorité pour tenter de mettre au clair les vies malmenées par le sort : l’écrivain. Ce sera le travail de Nathan Zuckerman (le sage ?) qui expliquera tardivement, dans la carrière que lui offre Roth : « l’histoire d’une vie est en soi et par définition un domaine dont l’intéressé sait fort peu de chose ». L’écrivain viendra à la rescousse des existences naufragées. Le salut par la littérature ?
Névrose, donc, puisque la «séance» est le moyen imaginé par Roth pour plonger son lecteur dans un cloaque intime. Névrose juive ? «Les Juifs» comme sujet littéraire font irruption de manière insolente, provocante, dans ce jeu de massacre familial qu’est La Plainte de Portnoy : c’est la tribu. Roth peint là son premier tableau de famille détaillé (bien plus fouillé que dans « Goodbye, Columbus »), qu’il ne cessera d’agrandir de livre en livre, jusqu’à y faire entrer trois générations — autant dire l’Histoire. S’il faut en croire Nathan Zuckerman, un temps professeur de littérature, la fiction est le «lieu de révélation des secrets et des tabous1». Sous l’invocation d’un œdipe joyeusement parodique, Roth dessine le périmètre de ce qui sera, dans les grands romans des années 1990, le théâtre privilégié d’affrontements, de déchirements et de déchirures tragiques : la famille. Nous sommes pour l’instant dans la bouffonnerie. Sans doute s’amuse-t-il à grossir les traits, mêlant le grotesque, où les figures sont déformées, et le burlesque, qui noie le pathétique sous le rire. Mais comment oublier un instant que l’histrion se débat parmi des images ? Tout ici, dans le huis clos du cabinet du médecin, est fantasmagorie, spectacle. La vie sexuelle flamboyante et lamentable d’Alexander Portnoy racontée par lui-même est la représentation d’une représentation. La crudité des mots et des choses ne renvoie pas à une esthétique réaliste, et la satire cède constamment sous la puissance déchaînée des affects. Si l’on veut connaître l’œil précis de Roth documentariste, il faut lire ou relire Le Complot contre l’Amérique (2004), qui filme, caméra à l’épaule, les terreurs d’une famille juive sous la menace d’un antisémitisme d’État. Pour ce qui est du monde juif dans La Plainte de Portnoy, qu’en dire ? Le père et la mère de ce fils trop bien et trop mal aimé appartiennent au folklore de ses parents et de ses ancêtres. « Les Juifs » ? Il n’est peut-être pas de commentaire plus mystérieusement éloquent sur le sujet que la réponse faite à Nathan Zuckerman, le jeune apprenti écrivain, par Emmanuel Isidore Lonoff, le maître vénéré auprès duquel il est venu chercher la bénédiction de sa vocation d’écrivain : «vous écrivez sur les Juifs», remarque Zuckerman. «Ce qui prouve ?» lui répond Lonoff. Le monde juif, l’être juif, la conscience juive, la judéité — le thème que suggèrent ces termes est, chez Philip Roth, non pas une donnée prête à l’emploi littéraire dont il s’empare pleinement une fois pour toutes au début de son œuvre, pour la faire varier ou la moduler ensuite. C’est une question (étymologiquement : une quête) inscrite au cœur de son univers romanesque, qui se déploie, se développe dans sa complexité et ses vertigineuses contradictions à mesure que cet univers se construit. Juif ? Philip Roth l’est, et surtout il le devient livre après livre, dans ses personnages, les vies et contrevies qu’il s’invente avec eux et contre eux, explorant sans relâche, pour la mettre à nu, selon une exubérante arborescence assez semblable à ce qu’on trouve chez Henry James et William Faulkner, ce qu’il a appelé «une condition très singulière, moralement éprouvante», liée à une situation historique difficile. Ces mots, vagues, nous suffiront ici pour désigner l’espace d’un drame que Philip Roth parcourt en tout sens en racontant ses histoires inquiètes, souvent comiques, avec les ressources ordinaires et extraordinaires de l’écrivain : les mots.
Philippe Jaworski.
1. Ma vie d’homme, p. 573.
Auteur(s) associé(s)



 Agrandir
Agrandir Diminuer
Diminuer